The Root Blog
Bienvenue sur ce blog rédigé par Bat Jacl
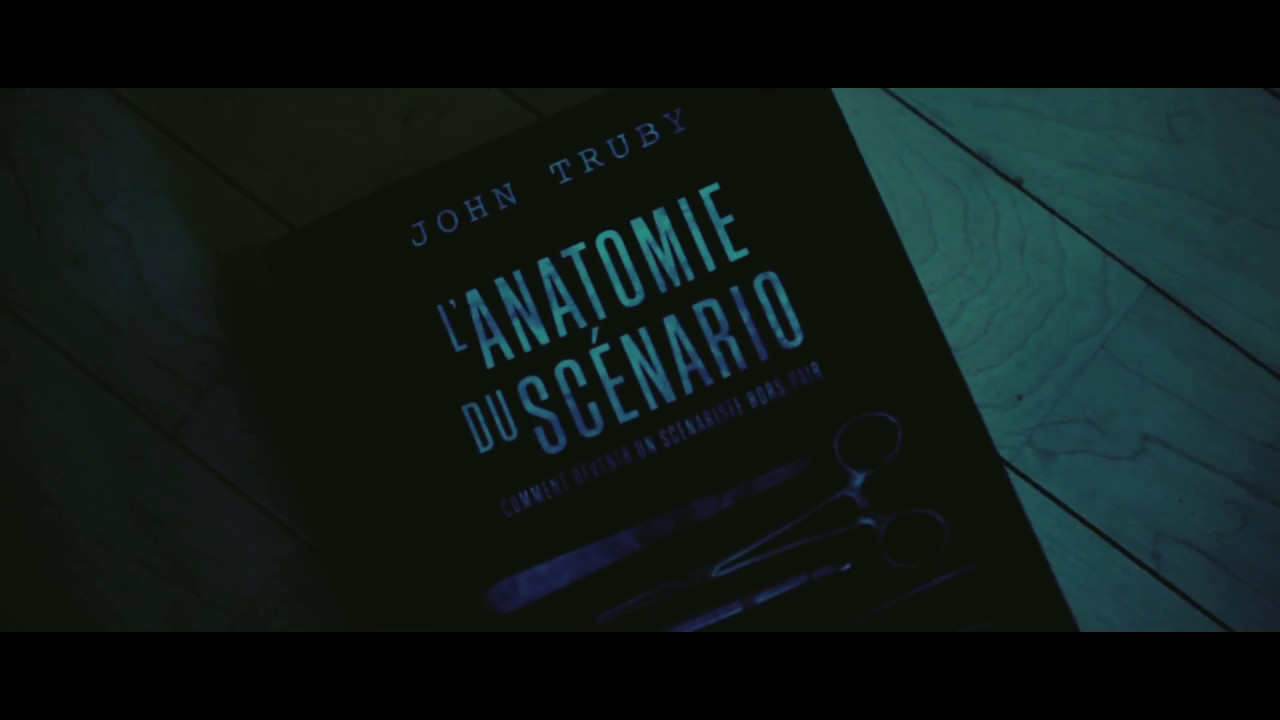
John Truby et l'Anatomie du Scénario : Guide pour les Écrivains en Herbe
Écriture, 21 juin 2023 11:32
Si vous êtes un.e écrivain.e en herbe et que vous cherchez à écrire une histoire avec une structure solide,
Ou que vous avez déjà écrit une histoire et qu’elle ne vous parait pas aussi captivante qu’elle pourrait l’être,
J’ai peut-être une idée à vous proposer.
Bien évidemment, on va parler de construction de scénario en amont du premier jet, donc je m’adresse surtout aux écrivain.e.s de types « Architecte ».
Est-ce que tu connais John Truby ?
Un magicien moderne qui argue pouvoir transformer n’importe quelle histoire en une œuvre inoubliable.
John Truby, un nom qui inspire le respect dans le monde du scénario
Né en 1952, John Truby s'est imposé comme une référence incontournable en tant que scénariste, réalisateur, professeur de scénario et auteur américain. Avec plus de mille consultations de scénarios de films à son actif sur une période de trois décennies, Truby s'est forgé une solide réputation dans l'univers du cinéma.
Notamment, car il a été critique de la célèbre structure en trois actes.
Il est l'auteur de "Anatomie du scénario", un livre qui se propose d'améliorer l'art de l'écriture de scénarios.
Anatomie du scénario, de son titre en anglais : « 22 Steps to becoming a master Storyteller »
Et rien que ça !
Selon Truby, l'art de raconter des histoires est un métier qui requiert une certaine maîtrise des règles avant de pouvoir prétendre à l'art. C'est ce qu'il explique dans son ouvrage, "Anatomie du scénario". Grâce à sa méthode unique, il dévoile les secrets d'une histoire réussie et guide le lecteur pas à pas dans la création de personnages, l'élaboration de l'intrigue, la conception de l'univers du récit et la rédaction des dialogues.
Tout cela se déroule en vingt-deux étapes, qui, selon lui, permettent l'écriture d'un bon scénario.
L'intrigue selon John Truby
Selon Truby, de nombreux auteurs ne prêtent pas suffisamment d'attention à l'intrigue. Ils ont souvent tendance à la confondre avec l'histoire ou à penser qu'elle ne fait que relater les actions du héros pour atteindre son but. Or, pour Truby, l'intrigue est bien plus que cela. Elle entrelace les lignes d'action et les événements en arrière-plan pour permettre à l'histoire de se dérouler progressivement du début à la fin.
L'intrigue organique
Dans une intrigue dite "organique", chaque action est proportionnée (en termes de longueur et de rythme) et les événements semblent découler directement du personnage principal. Tous les événements forment un tout cohérent, et chaque élément est indispensable à l'ensemble.
Les 22 étapes décrites dans l’anatomie du scénario :
Étape 1 : Définir clairement la révélation
La révélation finale du héro ou de l'héroine correspond au thème qu'on souhaite aborder : la première étape de travail est donc de partir de la fin (où veut-on amener l'histoire ?) pour déterminer clairement la révélation que devra subir notre héro ou héroine. Ce sera notre 'cadre' pour la suite.
Qu'est-ce que le héro ou héroine va apprendre à la fin ?
Ces questions doivent permettre de rédiger clairement notre thématique (la "morale de l'histoire"), en une phrase.
Étape 2 : Définir l'univers du récit et la 'backstory' du héro ou héroine
L'univers choisi doit être ciblé sur le thème et doit être parfaitement adapté au héro ou héroine et à l'histoire que vous voulez conter. Le lieu et l'époque doivent servir l'intérêt de l'histoire, et donc être choisis en fonction du thème que l'auteur.e souhaite développer.
Ce que Truby nomme ici "backstory" est la place du héro ou héroine dans cet univers (à quel endroit, à quel moment). Cela concerne aussi voire surtout le passé du héro ou héroine (et des autres personnages majeurs).
Étape 3 : Définir le besoin et les faiblesses du héro ou héroine
Tout bon héro ou héroine a un besoin, profond, qu'il ou elle devra accomplir (même s'il ou elle n'en a pas conscience au début). Il ou elle a aussi une ou plusieurs faiblesses qui tendent à l'entraver.
Faiblesse psychologique
Dans la plupart des histoires, le héro ou héroine a une faiblesse psychologique, une faiblesse qui ne fait de mal qu'à lui-même ou elle-même mais l'empêche de satisfaire un besoin profond (dont il ou elle n'a pas conscience). Ce n'est que lors de la confrontation avec l'adversaire que le héro ou héroine se rend compte de son besoin profond et de la faiblesse qui l'empêche de le combler. Il ou elle tente alors de surmonter ça (et dans la plupart des histoires, le héro ou héroine finit par y réussir).
Faiblesse morale
Dans les meilleures histoires, le héro ou héroine a aussi une faiblesse morale : il ou elle 'blesse' moralement quelqu'un d'une manière ou d'une autre (notion d'évolution du personnage). Cela empêche le héro ou héroine d'être parfait. Le lecteur est censé être vexé/choqué en même temps que le personnage 'blessé'. L'évolution du héro ou héroine à la fin de l'histoire doit permettre au personnage blessé (et au lecteur) de lui pardonner. Cela souligne d'autant plus son évolution.
Étape 4 : Définir le désir du héro ou de l'héroine (objectif)
Le désir (à ne surtout pas confondre avec le besoin), c’est ce que le héro ou l'héroine souhaite obtenir, son objectif dans l’histoire. C’est la piste que le public va suivre avec le héro ou l'héroine.
Le désir doit augmenter d’intensité au fur et à mesure de l’histoire.
Un désir faible (et qui le reste au fil de l’histoire) rabaisse le héro ou l'héroine et rend toute complexité de l’histoire impossible. Le plus faible degré de désir est la survie : cela rabaisse le héro ou l'héroine au stade animal.
Étape 5 : Choisir un événement déclencheur
Petite étape, elle a une fonction importante : c’est ce qui force le héro ou l'héroine à entrer dans l’action. Structurellement c’est souvent ce qui relie le besoin et le désir : le héro ou l'héroine a un besoin dont il ou elle n’a pas conscience, et l’événement déclencheur est ce qui lui apporte une tentation provoquant le désir.
Étape 6 : Choisir un ou des allié(s) au héro ou l'héroine
L’allié a plusieurs fonctions : porte-parole du héro ou de l'héroine, il doit lui apporter une aide mais être aussi son faire-valoir. C'est surtout un moyen pour l'auteur.e de mettre en relief le héro ou l'héroine, et donc en général l'allié ne doit pas trop ressembler au héro ou à l'héroine.
Important : l’allié ne doit pas être plus intéressant que le héro ou l'héroine. Sinon c’est que vous vous êtes trompé.e de protagoniste pour votre roman. Réécrivez en inversant tout ça !
Étape 7 : Choisir l’adversaire (et/ou mystère)
L’adversaire est le personnage qui va empêcher, volontairement ou pas, le héro ou l'héroine d’assouvir son désir. Cela ne signifie pas qu’il doit absolument être ‘mauvais’ ou ‘méchant’. Mais il doit y avoir obligatoirement conflit, conflit dont la résolution exposera le thème de l’histoire. Attention, ici, je parle de « Conflit » dans le sens dramaturgique du terme. Et pas dans le sens d’une guerre ou d’un combat. Si ce n’est pas clair pour vous, laissez moi un message en dessous, et je pourrais écrire un futur article dessus. L’adversaire doit être choisi en fonction du héros ou de l'héroine. Il doit avoir un lien fort avec la thématique du récit. Il doit y avoir une sorte de « triangle amoureux » entre héros, adversaire, et thématique du récit. La relation adversaire / héros est la plus importante de toutes les relations de l’histoire.
Étape 8 : Possibilité à étudier : Faux allié/adversaire
Le personnage du traître est toujours fascinant en terme de narration et de retournement de situation. Vous devriez envisager la possibilité d’en intégrer un :
- un faux allié, qui va trahir le héros ou l'héroine
- ou un faux adversaire, personnage qui semblera nuire mais qui au final sera une aide (ex : Le professeur Rogue dans la série des Harry Potter).
Étape 9 : Définir la première révélation : décision et modification du désir
Il est important de réfléchir à ce qui sera la première « grosse révélation » de l’histoire, qui fera basculer l’intrigue dans le vif du sujet pour de bon. A ce moment de l’histoire (souvent tôt, peu après l’événement perturbateur), le héros fait une découverte surprenante qui le force à prendre une décision et emprunter une nouvelle direction. Elle peut aussi l’amener à préciser son désir et ses motivations.
Étape 10 : Imaginer le plan du héros
Il est important de se mettre dans la peau de son héros ou de son héroine et d’imaginer avec lui / pour lui les actions qu’il peut mettre en œuvre pour atteindre son désir.
Étape 11 : Imaginer le plan de l’adversaire
L’adversaire aussi a un plan, souvent bien plus complexe et élaboré que celui du héros ou de l'héroine! Il faut particulièrement insister sur cette phase, car du plan de l’adversaire dépendent la quasi-totalité des révélations de l’histoire.
Étape 12 : Confronter les deux : dynamique du récit
Cette étape de travail correspond à la collision entre les deux plans (étapes 10 et 11) et enchaînement des actions. En général l’adversaire remporte plusieurs ‘victoires’ et reste, une bonne partie de l’histoire, intouchable pour le héros ou l'héroine.
Étape 13 : Utiliser la faiblesse morale du héros : attaque par un allié
Au cours de l’histoire, par désespoir ou frustration, le héros ou l'héroine peut réaliser des actions immorales en rapport avec ses faiblesses. Dans ce cas un personnage (souvent allié) peut intervenir pour se confronter à lui (le plus souvent verbalement) et lui reprocher son attitude.
Étape 14 : Imaginer une « apparente défaite »
Alors ça, je suis désolé, mais une fois que vous le découvrez, vous allez quasiment vous faire spoiler toutes les fins en avance ! à savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. Vers les 2/3 ou 3/4 de l’histoire, le héros ou l'héroine vit une défaite qui laisse à penser que tout est perdu. Il a atteint son point le plus bas, il touche le fond. Cet apparente défaite force le héros à se relever « d’en bas » et à se remettre en selle. La victoire finale n’en est alors que plus belle. à l’inverse, si jamais la fin doit être mauvaise, faites croire à votre héros ou héroine que tout va pour le mieux !
Étape 15 : Définir une deuxième révélation
Après l’apparente défaite, le héros ou l'héroine a une nouvelle révélation qui relance l’histoire et fait comprendre que la victoire est encore possible. Il est important de définir les étapes 14 et 15 ensemble pour cela soit cohérent et crédible : il faut vraiment que le lecteur croit à la défaite… mais que le rebond de l’étape 15 soit crédible.
Étape 16 : Dévoilement (lecteur)
Demandez-vous s’il est possible, d’un point de vue narratif par rapport à votre récit, d’utiliser l’ironie dramatique : un dévoilement est un moment où le lecteur – mais pas le héros ! – apprend une nouvelle information.
Étape 17 : Dévoilement (héros ou héroine)
Si vous intégrez un dévoilement, il faut peu de temps après que le héros ou l'héroine apprenne ce que le lecteur a découvert.
Actuellement, dans beaucoup d’histtoire, le héro l’apprend de la bouche même de l’adversaire : ce dernier révèle tous les secrets encore cachés car il pense avoir gagné.
Mais vraiment, ne faites pas ça. En 2023, on peut clairement faire mieux.
Cette révélation – malgré que ce soit souvent une mauvaise nouvelle – galvanise le héros ou l'héroine car il sait désormais contre qui il lutte vraiment. Les masques sont tombés, les mystères ont disparu, la lutte finale approche…
Étape 18 : Créer des scènes clefs : Porte étroite, Fourches Caudines, Vision de la mort
Ce sont 3 étapes ‘mobiles’ que l’on peut retrouver à différents endroits du récit, souvent dans le dernier tiers, sont des scènes fortes.
- Vision de la mort : Scène où le héros prend conscience de sa propre mortalité, et du fait que cette histoire peut lui faire perdre la vie.
- Fourches caudines : Scène où le héros est contraint de vivre une scène humiliante et terriblement difficile.
- Porte étroite : Scène où le héros doit passer par un passage physiquement étroit, souvent sous une menace pressante.
Étape 19 : Mettre en scène la confrontation
Il faut bien sûr mûrement réfléchir le conflit final. L’idéal étant que derrière un éventuel affrontement physique violent transparaissent clairement les valeurs et idées des personnages (le thème).
Étape 20 : Organiser la révélation du héros ou de l'héroine
L’épreuve de la confrontation doit permettre de faire exploser le thème dans la tête du lecteur. Le héros est amené à changer vraiment, en prenant conscience pour la première fois de son réel besoin, et en ayant l’occasion de le satisfaire (parfois au détriment de son désir initial). Tout conduit à ce point (première étape de Truby).
Le thème défendu par l’auteur doit alors se retrouver dans la combinaison des deux révélations.
Étape 21 : Illustrer la décision morale
Une fois que le héros a compris ses faiblesses et son besoin, il doit prendre une décision. C’est la toute dernière étape de l’évolution du personnage : c’est à ce moment qu’il prouve au lecteur qu’il a changé (ou qu’il en est incapable).
Étape 22 : Décrire le nouvel équilibre
Une fois que le besoin a été comblé (ou pas, dans le cas d’une tragédie), les choses reprennent un cours normal. Le nouvel équilibre n’est PAS un retour à la situation initiale, il montre la différence avec le début de l’histoire, à savoir le changement du héros ou de l'héroine.
Si vous voulez plus de détails sur ces 22 étapes, je vous conseille l’excellent article disponible sur DraftQuest.
Pour aller encore plus loin, je vous recommande de vous procurer le livre directement : L'anatomie du scénario.
Vous y retrouverez un énorme chapitre sur la construction de l’univers, les 7 étapes cruciales selon John Truby, et le tout agrémenté de nombreux exemples tirés du cinéma.
En exclusivité et en très mauvaise qualité : Voici le plan de mon roman « Le Sans-nom », structuré avec la méthode Truby. (Et je vous conseille beaucoup les post-its !)
Réévaluation de la méthode Truby : ses atouts et ses défauts
Atouts :
La méthode Truby, dotée de sa précision et de sa définition claire, offre une ossature robuste pour votre récit. Elle incite à une harmonie entre personnages, thèmes et intrigue, qui donne lieu à une histoire unifiée et plus profonde.
Cette méthode agit comme une liste de contrôle pour votre histoire. Si vous avez coché la plupart des cases dans le premier acte, vous savez que vous avez une base solide pour aller de l'avant. Il y a plus de structure ici à travailler que certaines des autres structures mentionnées dans cette liste. Cette liste pourrait bien fonctionner pour un écrivain qui aime beaucoup planifier à l'avance.
Défauts :
Cela dit, elle comporte également des défauts. Certains peuvent la percevoir comme étant rigide. Les écrivains en herbe peuvent également la trouver complexe à mettre en œuvre sans une certaine familiarité. Cette structure peut être trop prescriptive pour certains écrivains, car elle insiste sur des éléments qui ne sont pas essentiels à 100% pour toutes les histoires. Bien qu'elle représente une grande partie du travail de fond qui doit être fait dans l'Acte 1, cette structure peut ne pas être utile pour les écrivains qui ont du mal dans l'Acte 2. Et elle peut avoir un rythme inégal (mais ça, ça peut se changer, car comme le dit John Truby, les 22 étapes ne se mettent pas forcément dans l’ordre, on peut modifier).
En guise de conclusion
Cette méthode, bien qu'elle puisse être perçue comme une vision hollywoodienne et simpliste de la dramaturgie, possède son charme et sa valeur. Certes, certains films qui suivent cette recette peuvent parfois nous submerger par leur qualité variable. Il est clair que cette structure seule ne garantit pas la réalisation d'un livre exceptionnel.
Néanmoins, il est indéniable que plusieurs ont su tirer parti de cette approche pour donner naissance à des histoires captivantes. L'astuce réside dans l'adaptation flexible de ce modèle à votre œuvre : s’en servir comme une trame de réflexion, travailler dessus, puis peaufiner la véritable essence de votre récit.
Pour les novices qui tâtonnent à établir un plan ou pour ceux moins familiarisés avec l'art de la scénarisation, cette méthode peut s'avérer d'une aide précieuse. Il est essentiel de ne pas y adhérer aveuglément, mais d’y voir plutôt un allié potentiel dans l'élaboration de votre histoire.
John Truby lui-même soutient que toutes les étapes ne sont pas impératives. Pour ceux qui n’ont jamais esquissé un plan complet avant de se lancer dans l'écriture, cette méthode pourrait être l'impulsion nécessaire à leur processus créatif !
(je vous vois, vous, les petit.e.s jardinier.ère.s des histoires !)
FAQ
1. En tant qu'écrivain.e débutant.e, puis-je utiliser la méthode de Truby ?
Oui, absolument. La méthode de Truby est un excellent point de départ pour les écrivain.e.s en herbe. Elle vous fournit une structure détaillée pour construire votre histoire. Cependant, il est important de ne pas la considérer comme une règle rigide, mais plutôt comme un guide qui peut être ajusté selon votre style et les besoins de votre histoire.
2. La méthode de Truby est-elle seulement pour les films ?
Non, la méthode de Truby est adaptable à tous les types de récits, que ce soit pour un film, une pièce de théâtre, un roman ou une bande dessinée. Elle fournit un cadre de travail qui peut vous aider à développer des personnages crédibles, une intrigue captivante et des thèmes profonds, quel que soit le medium que vous choisissez.
3. Qu'arrive-t-il si je saute certaines étapes de la méthode de Truby ?
John Truby lui-même a déclaré que toutes les étapes ne sont pas obligatoires. L'important est de
comprendre l'objectif de chaque étape et comment elle peut enrichir votre histoire. Si vous sentez que certaines étapes ne s'appliquent pas à votre récit, n'hésitez pas à les adapter ou même à les sauter.
4. Comment puis-je éviter que mon histoire ne semble trop scryptée en utilisant la méthode de Truby ?
La clé est de vous approprier la méthode de Truby. Utilisez-la comme une source d'inspiration et un guide, mais n'hésitez pas à la personnaliser. L'objectif n'est pas de cocher toutes les cases, mais de créer une histoire qui soit authentique et qui résonne avec votre public.
5. Comment puis-je savoir si j'utilise correctement la méthode de Truby ?
La meilleure façon de vérifier est de lire votre histoire à voix haute, de la partager avec des personnes de confiance ou de travailler avec un mentor ou un groupe d'écriture. Si votre histoire est engageante, si vos personnages sont crédibles et si vos thèmes sont clairement définis, alors vous utilisez probablement la méthode de Truby de manière efficace. N'oubliez pas que l'écriture est un art, et même si la méthode de Truby est un excellent outil, elle ne remplacera jamais votre intuition et votre créativité en tant qu'écrivain.